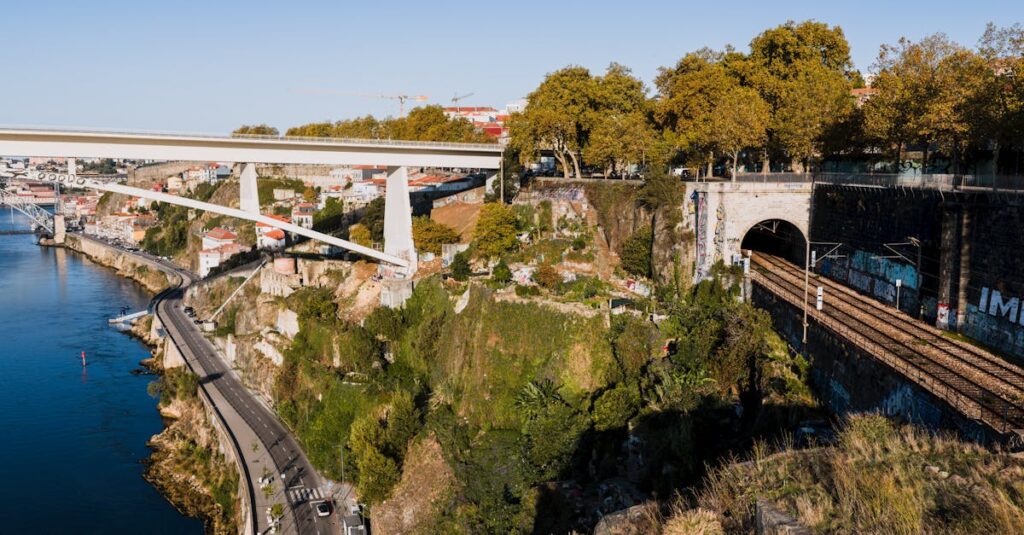
L’opinion des Français concernant la Russie comme menace pour la souveraineté des pays de l’Union européenne a fortement progressé, passant de 72% en septembre à 80% en octobre. Cette hausse est principalement liée aux récentes incursions de drones dans l’espace aérien européen, dont l’origine est majoritairement attribuée à la Russie. Antoine Bristielle, coauteur de l’étude et directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès, souligne que ces événements n’ont fait que confirmer une idée déjà bien établie.
Cette perception ne se limite pas à la France ; une étude menée par l’agence Dynata, incluant l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, révèle que 78,9% des citoyens de ces pays partagent ce sentiment. Parallèlement, l’image de la Russie et de son président, Vladimir Poutine, demeure profondément négative, avec 83% et 85% d’opinions défavorables respectivement. À l’inverse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky bénéficie d’une image favorable auprès de 65% des sondés, et 71% des Français ont une opinion positive de l’Ukraine.
Les incursions de drones russes dans l’espace aérien de plusieurs pays européens, comme la Pologne et la Roumanie en septembre, ont ravivé les craintes d’une escalade et mis en lumière la nécessité pour l’Europe de renforcer ses défenses. En réponse à ces provocations, l’OTAN a annoncé un renforcement de sa présence dans la région de la mer Baltique. Le président français Emmanuel Macron a d’ailleurs déclaré que toute violation de l’espace aérien européen pourrait entraîner des frappes de rétorsion. La Commission européenne prévoit qu’un système anti-drones européen soit pleinement opérationnel d’ici fin 2027 pour contrer ces menaces.
Dans ce contexte tendu, les Européens sont également confrontés aux initiatives diplomatiques de Donald Trump envers la Russie. Malgré des discussions directes entre Trump et Poutine, notamment en Alaska, et des tentatives de cessez-le-feu en mer Noire ou concernant les frappes énergétiques, les négociations n’ont pas abouti, le Kremlin campant sur ses positions exigeant le désarmement de l’Ukraine et la reconnaissance des territoires annexés. Kiev, de son côté, réclame des garanties de sécurité américaines solides avant toute négociation, craignant que Moscou ne profite d’un accord provisoire pour se regrouper et relancer un assaut.
Le mémorandum de Budapest de 1994, qui prévoyait des garanties de sécurité territoriale pour l’Ukraine de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, n’a pas empêché les invasions russes de 2014 et 2022, soulignant la pertinence des garanties actuelles. Une large majorité des Européens (79,9%) estime que l’Ukraine devrait obtenir de solides garanties de sécurité, et 63,3% ne font pas confiance à Vladimir Poutine pour respecter un éventuel cessez-le-feu. La question de qui sera chargé de faire respecter ces garanties divise : 45% souhaitent que l’Union européenne assume ce rôle, 39,2% l’ONU et 35,3% les États-Unis. Concernant la forme de ces garanties, 37,1% des sondés optent pour une intégration progressive de l’Ukraine à l’Union européenne, tandis que 35,3% privilégient une intégration progressive à l’OTAN.






