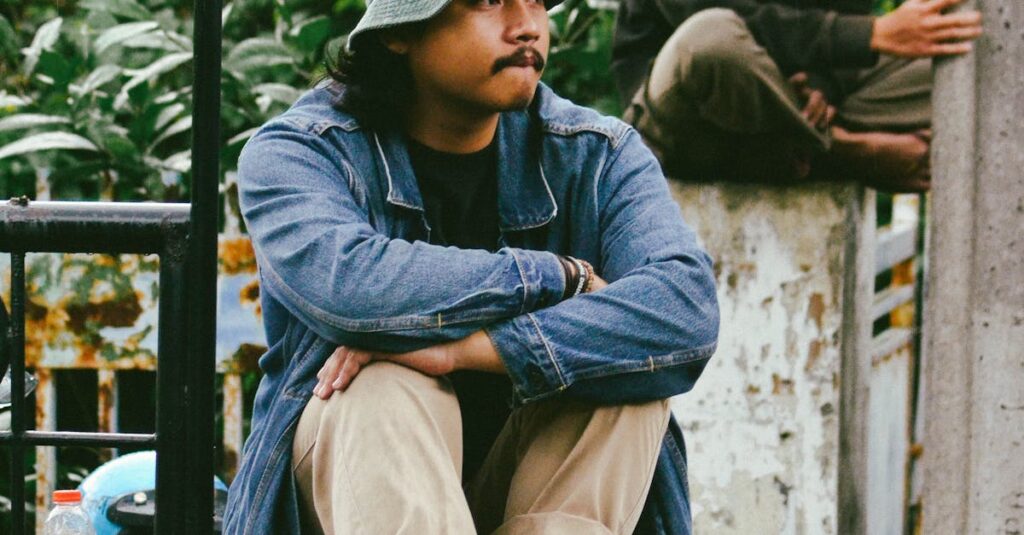
La France a connu une nouvelle journée d’action intersyndicale le 18 septembre, rassemblant des centaines de milliers de manifestants à travers le pays. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 500 000 personnes ont défilé, un chiffre qui a doublé selon la CGT. Cette mobilisation marque un retour en force pour les organisations syndicales, rappelant leur capacité à mobiliser observée lors du premier semestre 2023, lors des protestations contre la réforme des retraites. Cependant, le contexte actuel présente des spécificités notables.
Les manifestations du 18 septembre s’inscrivent dans la continuité du mouvement « Bloquons tout » lancé le 10 septembre sur les réseaux sociaux. Malgré les réserves initiales de certaines confédérations, comme la CFDT, il est plus pertinent d’analyser ces deux dates conjointement. L’élan du 10 septembre a sans aucun doute influencé l’intersyndicale, composée de huit organisations, à avancer son calendrier d’action, initialement prévu pour fin septembre ou début octobre. De plus, plusieurs structures professionnelles et territoriales (CGT, Solidaires, FSU et FO) ont également investi l’espace public numérique, amplifiant la résonance du mouvement.
La journée du 10 septembre, bien que n’étant pas un mouvement de masse, a servi de catalyseur pour celle du 18 septembre, générant une dynamique favorable au succès de la mobilisation. L’appel à « bloquer tout » n’a pas été l’échec prédit par le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Malgré un dispositif de maintien de l’ordre conséquent, reconduit le 18 septembre, le mouvement a réuni deux fois plus de participants que les estimations des renseignements territoriaux. Les syndicats évoquent même une fourchette haute de 250 000 à 300 000 personnes, des chiffres comparables à ceux des « gilets jaunes », un mouvement également né sur les réseaux sociaux. Cette résurgence de la contestation sociale indique une période de tensions persistantes.






