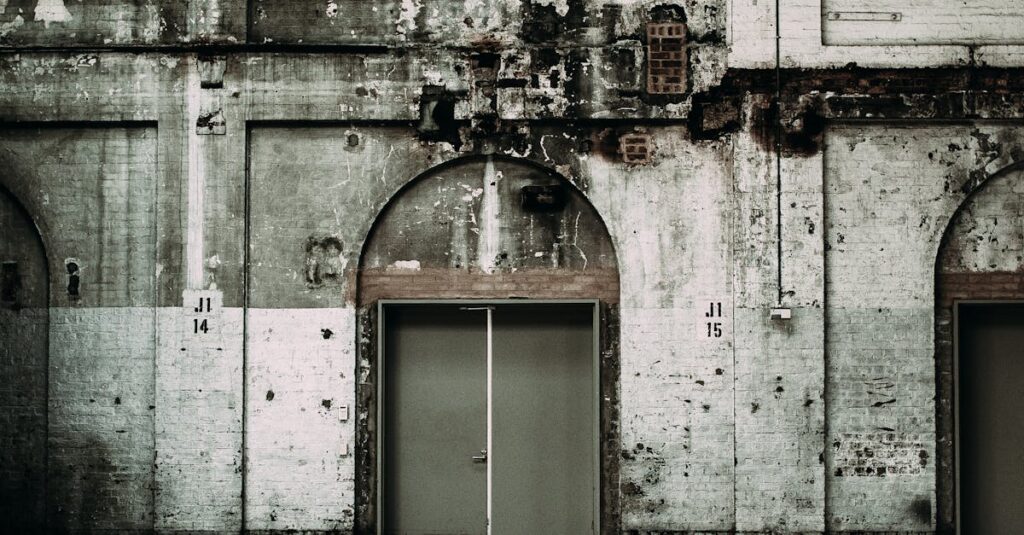
Un procès d’une ampleur inédite s’ouvre : la multinationale Lafarge et huit de ses anciens dirigeants sont devant la justice à partir du 4 novembre. Ils sont accusés d’avoir conclu des accords financiers avec des groupes djihadistes, y compris l’organisation État islamique. L’objectif aurait été de maintenir en activité l’usine de ciment de Jalabiya, située dans le nord de la Syrie.
Déjà poursuivie aux États-Unis pour des faits similaires, l’entreprise avait plaidé coupable devant la justice américaine en 2022. Ce dossier met en lumière les pratiques douteuses de l’entreprise pour préserver ses intérêts économiques dans une zone de conflit. La justice française cherche à élucider comment un géant industriel a pu se retrouver mêlé à de telles accusations.
Lafarge s’était implantée en Syrie dès 2008. L’éclatement de la guerre civile syrienne en 2011 a contraint de nombreuses entreprises françaises, telles que Total, Bel ou Air Liquide, à quitter le territoire. Cependant, Lafarge a pris la décision de maintenir l’activité de sa cimenterie syrienne, ce qui est aujourd’hui au cœur des accusations. Cette persistance interroge sur les motivations réelles de l’entreprise et les risques pris par ses dirigeants.
Le procès actuel devra déterminer l’étendue des responsabilités de Lafarge et de ses ex-dirigeants face à ces allégations graves de financement indirect du terrorisme. L’affaire, révélée au grand public par une enquête approfondie, souligne les défis éthiques et juridiques auxquels sont confrontées les entreprises opérant dans des régions instables, et les potentielles conséquences de leurs choix stratégiques.






