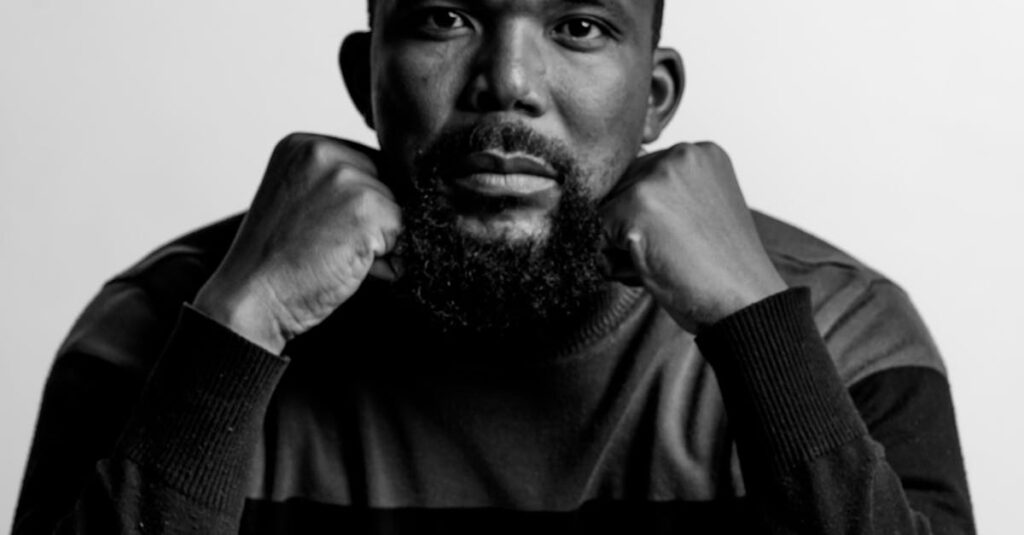
Le milliardaire et philanthrope George Soros suscite autant de fascination à gauche que d’obsession à droite. Mais son influence est-elle à la hauteur des croyances de ses partisans comme de ses détracteurs ? Promoteur d’un progressisme libéral depuis la chute du Mur de Berlin, le monde des illusions perdues de George Soros est sur le point de disparaître avec lui.
Alors que le milliardaire a revendiqué la postérité intellectuelle du philosophe Karl Popper, allant jusqu’à emprunter son concept central de « société ouverte » pour nommer son réseau philanthropique, cette filiation semble désormais en partie usurpée.
Arrivé à Londres en 1947 après un exode douloureux à travers l’Europe, le jeune George Soros a réussi, après deux ans d’efforts, à s’inscrire à la London School of Economics. Il se voyait alors professeur et philosophe, et il écrira plus tard de lui-même, à cette époque, dans un de ses livres : « Je m’imaginais comme une sorte de dieu, de réformateur de l’économie comme Keynes ou, mieux encore, comme un savant du genre Einstein ! ».
Ses ambitions intellectuelles n’ont cessé, depuis, d’être contrariées. Encore étudiant, il s’était d’abord mis en devoir d’écrire un premier livre de philosophie, une forme de traité sur la société, son organisation politique et la dialectique entre sociétés ouvertes et fermées. Cet essai intitulé The Burden of Consciousness (« Le fardeau de la conscience ») ne sera jamais publié. Et pour cause : aucune idée n’y est vraiment de lui. Tout est librement plagié, du propre aveu de Soros, de l’œuvre et de la pensée de Karl Popper.






